| Notre
corsaire à la guillotine |
| |
|
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 n mai
1751, était baptisé à Amiens (Somme) Jean-Baptiste
Ernest Buchère, fils unique par la mort de son frère
aîné, de Jean-François, bourgeois fortuné, seigneur
de l'Epinois, Président Trésorier de France en la
Généralité de Champagne, conseiller du Roi. n mai
1751, était baptisé à Amiens (Somme) Jean-Baptiste
Ernest Buchère, fils unique par la mort de son frère
aîné, de Jean-François, bourgeois fortuné, seigneur
de l'Epinois, Président Trésorier de France en la
Généralité de Champagne, conseiller du Roi.
 l portait
les armes familiales : l portait
les armes familiales :
"d'argent à un chevron d'azur, accompagné en
chef d'une étoile d'azur, à dextre d'un croissant aussi
d'azur, à sénestre et en pointe d'un mouton de sable"
et avait adopter la devise : "Fidelis ad mortem". |

|
| |
|
Jean-Baptiste
Ernest Buchère de l'Epinois
(1751-1794)
|
| |
|
|
 e sa petite
enfance, nous ne savons pratiquement rien, sinon qu'à
l'âge de 10 ans, il arrêta le latin et qu'il reçut
dès 12 ans une solide formation aux mathématiques, son
père le destinant à entrer dans le corps des
ingénieurs des Ponts et Chaussées. e sa petite
enfance, nous ne savons pratiquement rien, sinon qu'à
l'âge de 10 ans, il arrêta le latin et qu'il reçut
dès 12 ans une solide formation aux mathématiques, son
père le destinant à entrer dans le corps des
ingénieurs des Ponts et Chaussées.
Ce qui ne fut pas du goût de Jean-Baptiste, qui dès son
quinzième anniversaire s'engagea dans le 6e régiment de
dragons de la Reine attaché à la Compagnie de M.
d'Alvimart. |
| |
|
|
 on enthousiasme
le conduit au grade de Maréchal des Logis avant
d'obtenir en septembre 1770, le brevet de
sous-lieutenant, grâce au colonel Emmanuel-François de Grossolles, Comte de
Flamarens (v.1735-1782). on enthousiasme
le conduit au grade de Maréchal des Logis avant
d'obtenir en septembre 1770, le brevet de
sous-lieutenant, grâce au colonel Emmanuel-François de Grossolles, Comte de
Flamarens (v.1735-1782). |
| |
|
|
 l'automne
1774, Jean-Baptiste Buchère de l'Epinois sert dans les
armées du comte d'Artois en qualité de Porte-Arquebuse.
Mais sa carrière militaire va tourner court en fin
d'année 1779, suite à une violente querelle avec le
Prince d'Hénin (1748-1794), sieur d'Alsace de Boussut de
Chimay, capitaine des Gardes du Corps du Comte d'Artois. l'automne
1774, Jean-Baptiste Buchère de l'Epinois sert dans les
armées du comte d'Artois en qualité de Porte-Arquebuse.
Mais sa carrière militaire va tourner court en fin
d'année 1779, suite à une violente querelle avec le
Prince d'Hénin (1748-1794), sieur d'Alsace de Boussut de
Chimay, capitaine des Gardes du Corps du Comte d'Artois.
Il est contraint pour lors à l'exil. |
| |
|
|
 l décide alors
de "déclarer la guerre aux tyrans" en
s'embarquant en tant que corsaire-flibustier. l décide alors
de "déclarer la guerre aux tyrans" en
s'embarquant en tant que corsaire-flibustier.
 insi
pouvons-nous compter notre héros, au nombre de ses
aventuriers qui débarquèrent dans l'île de
Saint-Domingue, avant d'être forcé d'émigrer dans
l'île de la Tortue, au nord-ouest d'Haïti. insi
pouvons-nous compter notre héros, au nombre de ses
aventuriers qui débarquèrent dans l'île de
Saint-Domingue, avant d'être forcé d'émigrer dans
l'île de la Tortue, au nord-ouest d'Haïti. |
| |
|
|
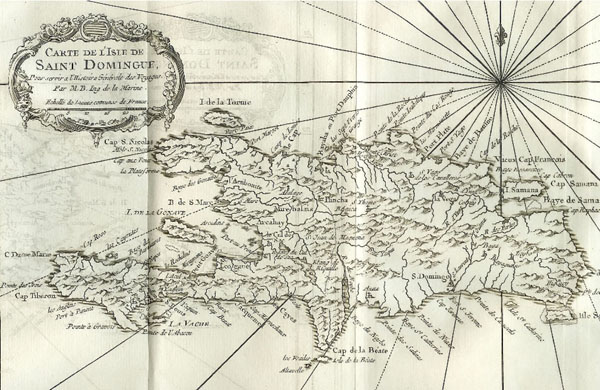 |
| |
|
|
 roisant dans le
golfe du Mexique, il acquit par ce métier une somme de
300.000 livres qu'il emploiera à l'achat d'une maison
"La Bombarde" à Saint-Domingue. roisant dans le
golfe du Mexique, il acquit par ce métier une somme de
300.000 livres qu'il emploiera à l'achat d'une maison
"La Bombarde" à Saint-Domingue. |
| |
|
|
 l n'oubliait
pas pour autant la France et plus particulièrement Le
Mesnil-Saint-Denis, où l'attendait sa femme
Marie-Alexandrine Aubilliard des Ambésis et ses enfants. l n'oubliait
pas pour autant la France et plus particulièrement Le
Mesnil-Saint-Denis, où l'attendait sa femme
Marie-Alexandrine Aubilliard des Ambésis et ses enfants.
 n effet en
1790, après avoir navigué deux années sur l'océan
atlantique, il débarqua au port du Havre, avant de
regagner Le Mesnil, alors en pleins troubles
révolutionnaires. n effet en
1790, après avoir navigué deux années sur l'océan
atlantique, il débarqua au port du Havre, avant de
regagner Le Mesnil, alors en pleins troubles
révolutionnaires. |
| |
|
|
 e 1er août
1790, les Mesnilois le nommèrent Major de la Garde
Nationale, fonction qu'il remplira jusqu'en novembre de
la même année, date à laquelle il fut à nouveau
contraint par suites d'une lettre de cachet stipulant son
expatriation, de repartir pour "la perle des
Antilles françaises", ainsi dénommait-on la
future Haïti, considérée comme la colonie la plus
florissante du monde entier. Cette prospérité reposait
sur l’esclavage. Il y avait 455.000 esclaves sur à
peine 510.000 habitants en 1791. e 1er août
1790, les Mesnilois le nommèrent Major de la Garde
Nationale, fonction qu'il remplira jusqu'en novembre de
la même année, date à laquelle il fut à nouveau
contraint par suites d'une lettre de cachet stipulant son
expatriation, de repartir pour "la perle des
Antilles françaises", ainsi dénommait-on la
future Haïti, considérée comme la colonie la plus
florissante du monde entier. Cette prospérité reposait
sur l’esclavage. Il y avait 455.000 esclaves sur à
peine 510.000 habitants en 1791. |
| |
|
|
 l retourna à
Saint-Domingue où il retrouva sa maison située dans le
quartier du Mole Saint-Nicolas. l retourna à
Saint-Domingue où il retrouva sa maison située dans le
quartier du Mole Saint-Nicolas.
Ses affaires fleurissaient et tout permettait à
Jean-Baptiste Ernest de se réjouir, lorsque
l'insurrection "des nègres" survint le 23
août 1791, avec pour conséquence l'incendie de sa
maison et la perte de sa fortune. |
| |
|
|
| |

|
|
| |
Début
de la grande insurrection de Saint-Domingue
|
|
| |
|
|
 a multiplicité
des camps qu'exigeait la guerre contre "les
nègres" nécessitait des officiers du génie.
Philibert-François Rouxel-Blanchelande (1735-1793),
gouverneur des Iles-sous-le-Vent, lui confia alors le
poste d'ingénieur au Camp du Haut du Cap, que
Jean-Baptiste Ernest fera fortifier. a multiplicité
des camps qu'exigeait la guerre contre "les
nègres" nécessitait des officiers du génie.
Philibert-François Rouxel-Blanchelande (1735-1793),
gouverneur des Iles-sous-le-Vent, lui confia alors le
poste d'ingénieur au Camp du Haut du Cap, que
Jean-Baptiste Ernest fera fortifier.
Durant cette période, il publie une loi intitulée
"Moyen de remédier aux désastres de cette
colonie, d'y rétablir la Paix, de faire rentrer les
esclaves dans les habitations et prévenir les
insurrections". |
| |
|
|
 a guerre civile
se poursuivant, Jean-Baptiste Ernest obtint en faveur des
services rendus à la colonie, un passage pour son retour
en France. a guerre civile
se poursuivant, Jean-Baptiste Ernest obtint en faveur des
services rendus à la colonie, un passage pour son retour
en France.
Il quitte Saint-Domingue le 14 septembre 1791 et après
une traversée à bord du "Prospère"
débarque à Nantes. |
| |
|
|
 e 3 octobre, il
arrive au Mesnil où il retrouve sa famille au château
des Ambésis. Dès lors il s'occupera de l'exploitation
des terres attachées à la ferme des Grands-Ambésis,
dont il était le propriétaire. e 3 octobre, il
arrive au Mesnil où il retrouve sa famille au château
des Ambésis. Dès lors il s'occupera de l'exploitation
des terres attachées à la ferme des Grands-Ambésis,
dont il était le propriétaire. |
| |
|
|
 i un certificat
de résidence, délivré par la commune en 1793, nous
décrit les traits de notre personnage : "Taille
5 pieds 4 pouces et demie (1 m 74) ; taille svelte
moulée dans toutes les proportions ; la tête chauve ;
sourcils châtains ; petits yeux enfoncés ; nez aquilin
; bouche petite ; le regard vif et fier d'un républicain
; le teint brûlé par le soleil ; le visage à
demi-ovale", une très belle miniature
d'époque (voir
ci-dessus) nous le
représente de profil et nous permet d'admirer son
effigie la tête coiffée d'une perruque à bourse. i un certificat
de résidence, délivré par la commune en 1793, nous
décrit les traits de notre personnage : "Taille
5 pieds 4 pouces et demie (1 m 74) ; taille svelte
moulée dans toutes les proportions ; la tête chauve ;
sourcils châtains ; petits yeux enfoncés ; nez aquilin
; bouche petite ; le regard vif et fier d'un républicain
; le teint brûlé par le soleil ; le visage à
demi-ovale", une très belle miniature
d'époque (voir
ci-dessus) nous le
représente de profil et nous permet d'admirer son
effigie la tête coiffée d'une perruque à bourse. |
| |
|
|
 es
responsabilités sur le plan local vont s'élargir
puisqu'en juillet 1792, il sera nommé sous-lieutenant de
la 1ère compagnie de la Garde Nationale, avant d'être
élu Capitaine et de prêter le serment le 28 octobre de
la même année. es
responsabilités sur le plan local vont s'élargir
puisqu'en juillet 1792, il sera nommé sous-lieutenant de
la 1ère compagnie de la Garde Nationale, avant d'être
élu Capitaine et de prêter le serment le 28 octobre de
la même année. |
| |
|
|
 l décide alors
de reprendre ces activités militaires et s'adresse à
Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827) inspecteur des Mines
afin d'obtenir un engagement. l décide alors
de reprendre ces activités militaires et s'adresse à
Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827) inspecteur des Mines
afin d'obtenir un engagement.
Sans succès, il décide de quitter Le Mesnil en
décembre 1792 pour se fixer à Paris.
Là, il s'occupera de dessin et disposera de 1.200 livres
de rente sur la ville, perçues par le citoyen La Place,
son cousin, homme de loi.
Il profite de son temps libre pour nous laisser des
écrits sur la capitale : "Projets et sujétions"
sur : "les Champs-Elysées" ; "Tuileries,
châteaux et Jardins" ; "Quai de la
Ferraille ou de la Mégisserie" ; "Place
de la Révolution" ; "Montmartre"
; "Quai de la Vallée ou des Grands-Augustins"...
et une satire sur "Mirabeau". |

|
| |
|
Jean-Henri
Hassenfratz
(1755-1827)
|
 oussé par la
volonté de servir la République, récemment proclamée
par Danton, il sollicita le 22 mars 1793, M. de Saudemont
qui, par retour de courrier lui répondit : -"La
loi du 21 février 1793 relative à la désorganisation
de l'armée me prive des moyens de vous obliger". oussé par la
volonté de servir la République, récemment proclamée
par Danton, il sollicita le 22 mars 1793, M. de Saudemont
qui, par retour de courrier lui répondit : -"La
loi du 21 février 1793 relative à la désorganisation
de l'armée me prive des moyens de vous obliger". |
| |
|
|
| Jean-Baptiste
Ernest est furieux. Une fois de plus, on l'empêche, lui
l'homme d'action, le risque-tout, de se battre contre les
despotes et le despotisme. Et bien, on va voir ! |
| |
|
|
 'est alors
qu'il se trouva mêlé à une fâcheuse affaire. 'est alors
qu'il se trouva mêlé à une fâcheuse affaire. |
| |
|
|
 |
 rrêté à la
fin mai 1793, il fut impliqué dans la "Conspiration
des Prisons" accusé d'être complice d'Hébert
(1757-1794) et "associé de Ronsin". rrêté à la
fin mai 1793, il fut impliqué dans la "Conspiration
des Prisons" accusé d'être complice d'Hébert
(1757-1794) et "associé de Ronsin".
Le 1er juin, il comparait devant l'Administrateur du
Département de Police, qui déclare avoir trouvé dans
son appartement des papiers compromettant pour lui. |
Jacques
René Hébert (1757-1794)
|
|
|
| Le 24 juillet 1793,
il comparait devant le Tribunal Révolutionnaire,
présidé par Jacques Bernard Montané, en présence de
Fouquier-Tinville, accusateur public. |
 e 19
germinal An II, Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, dresse
l'acte d'accusation sur lequel figure Jean-Baptiste
Ernest, en compagnie de 28 individus, parmi lesquels
Jean-Baptiste Gobel (1727-1794) Evêque de Paris ;
Pierre-Gaspard Chaumette dit Anaxagoras (1763-1794) Agent
national de la commune de Paris ; Anne-Philippe Lucile
Laridon-Duplessis veuve Camille Desmoulins (1771-1794) ;
Arthur Dillon (1750-1794) général de l'armée des
Ardennes, représentant des Etats-Généraux...
etc...tous "convaincus" sans preuve, pièce, ni
témoin, d'être "les auteurs ou complices de la
conspiration qui a existé contre la liberté, la
sûreté et la souveraineté du peuple, la destruction du
gouvernement républicain ... et d'avoir
comploté pour délivrer Marie-Antoinette et tenter de
replacer sur le trône "le fils du tyran" (Louis XVII). e 19
germinal An II, Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, dresse
l'acte d'accusation sur lequel figure Jean-Baptiste
Ernest, en compagnie de 28 individus, parmi lesquels
Jean-Baptiste Gobel (1727-1794) Evêque de Paris ;
Pierre-Gaspard Chaumette dit Anaxagoras (1763-1794) Agent
national de la commune de Paris ; Anne-Philippe Lucile
Laridon-Duplessis veuve Camille Desmoulins (1771-1794) ;
Arthur Dillon (1750-1794) général de l'armée des
Ardennes, représentant des Etats-Généraux...
etc...tous "convaincus" sans preuve, pièce, ni
témoin, d'être "les auteurs ou complices de la
conspiration qui a existé contre la liberté, la
sûreté et la souveraineté du peuple, la destruction du
gouvernement républicain ... et d'avoir
comploté pour délivrer Marie-Antoinette et tenter de
replacer sur le trône "le fils du tyran" (Louis XVII). |

|
| |
|
Antoine
QuentinFouquier-Tinville
(1746-1795)
|
| |
|
|

|

|

|
Pierre-Gaspard
Chaumette dit Anaxagoras (1763-1794)
|
Anne-Philippe
Lucile Laridon-Duplessis
veuve Camille Desmoulins (1771-1794)
|
Arthur
Dillon (1750-1794)
|
| |
|
|
 amené le soir
même à la maison de la Conciergerie où il était
emprisonné, Jean-Baptiste Ernest Buchère de l'Epinois,
dut comparaître le surlendemain 21 germinal An II, salle
de la Liberté, à 10 heures du matin afin d'entendre sa
sentence. amené le soir
même à la maison de la Conciergerie où il était
emprisonné, Jean-Baptiste Ernest Buchère de l'Epinois,
dut comparaître le surlendemain 21 germinal An II, salle
de la Liberté, à 10 heures du matin afin d'entendre sa
sentence.
Le président René-François Dumas (1758-1794) qui
envoya à la guillotine Mme Roland, la Reine, Danton,
Hébert...les condamna tous "à la peine de
mort" et leurs biens acquis à la République. |
| |
|
|
 e 24 germinal
An II ou le dimanche 13 avril 1794, à six heures du
soir, Jean-Baptiste Ernest Buchère de l'Epinois ainsi
que ces compagnons que l'on appellera plus tard "les
Hébertistes" ou "les Enragés",
furent conduit sur la place de la Révolution. e 24 germinal
An II ou le dimanche 13 avril 1794, à six heures du
soir, Jean-Baptiste Ernest Buchère de l'Epinois ainsi
que ces compagnons que l'on appellera plus tard "les
Hébertistes" ou "les Enragés",
furent conduit sur la place de la Révolution.
|
| |
|
|
 n y voit
l'échafaud sur lequel se dressent la guillotine et le
bourreau. n y voit
l'échafaud sur lequel se dressent la guillotine et le
bourreau. |
| |
|
|
| |
 |
 |
| |
Supplice
des Hébertistes
gravure de P.G. Berthault d'après J.Duplessis-Bertaux
|
|
| |
|
|
| |
 n long moment
de silence... et tombe le couteau ruisselant de sang. n long moment
de silence... et tombe le couteau ruisselant de sang.
 
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| ©
Olivier Fauveau - 2004 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
 Retour
à l'accueil
Retour
à l'accueil
|
|
| |
|
|


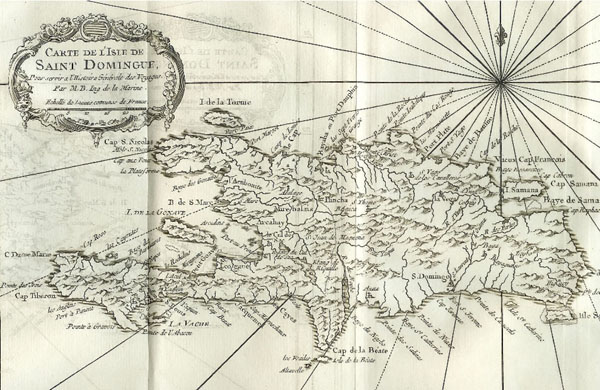









![]() n long moment
de silence... et tombe le couteau ruisselant de sang.
n long moment
de silence... et tombe le couteau ruisselant de sang.
![]()
![]()